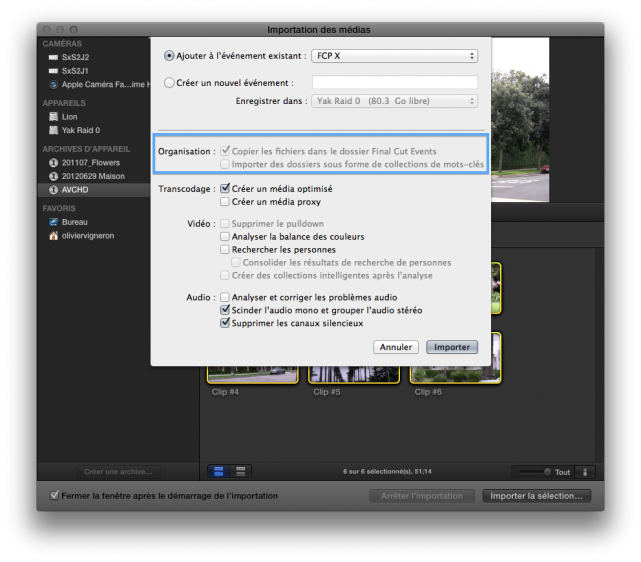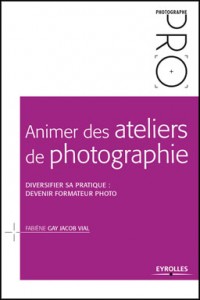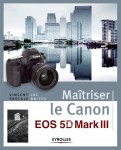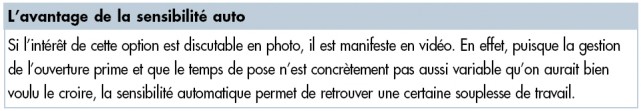Camera Raw et DNG Converter 8.1 : sortie des versions finales
Publié le 11 juin 2013 dans Actualités par Volker Gilbert

Adobe vient de publier les versions finales de Camera Raw et DNG Converter 8.1. Désormais, Camera Raw offre une prise en charge des écrans de haute résolution (Apple Retina) et des formats RAW de plusieurs boîtiers récents. Le plug-in pour Photoshop CS6 introduit de nouveaux profils de correction optique et corrige un certain nombre de bogues de la version précédente (ACR 7.4).