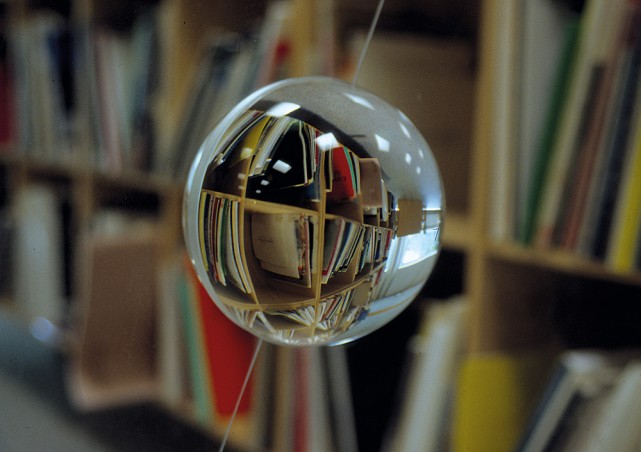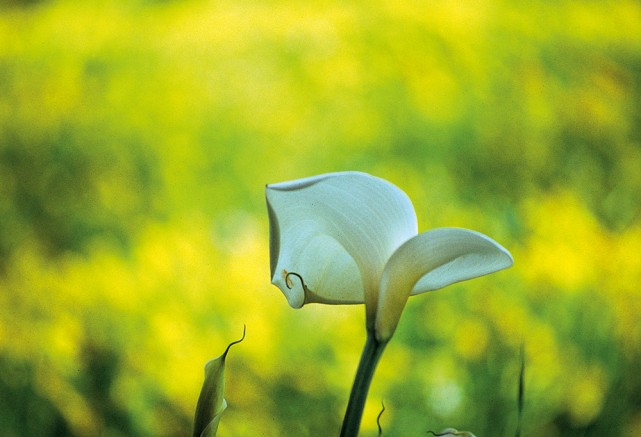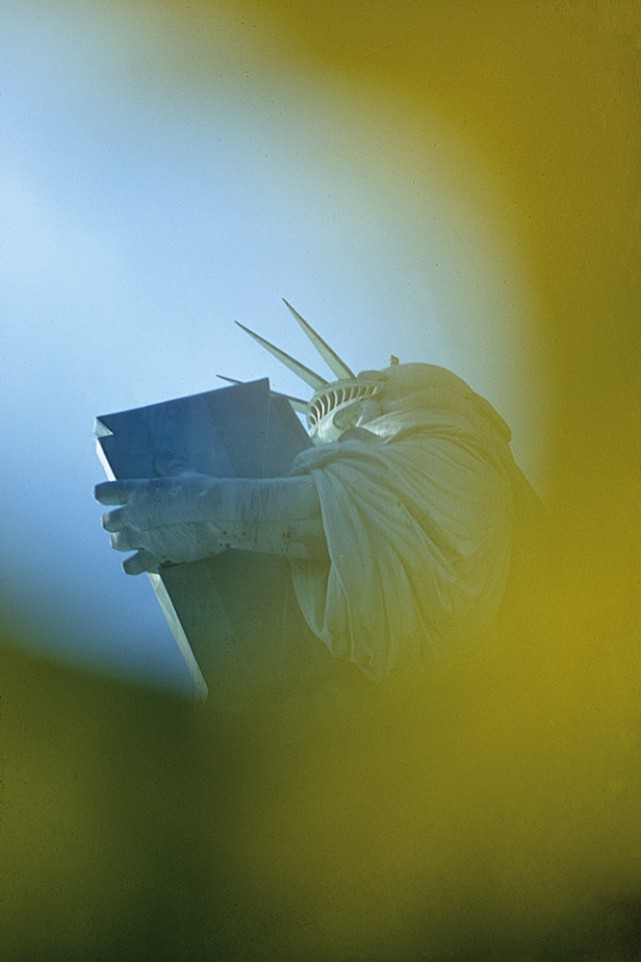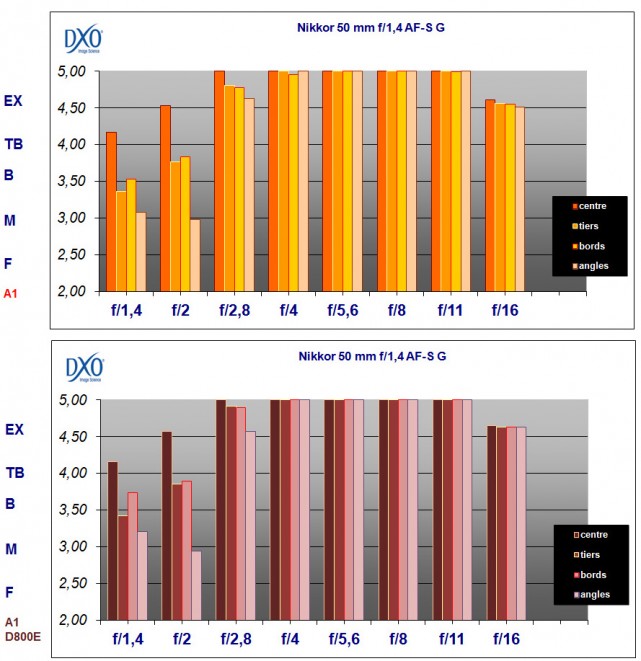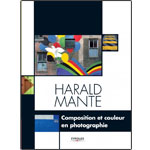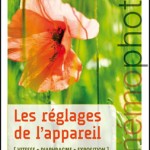Camera Raw et Lightroom : sortie des versions bêta publiques 7.2 et 4.2
Publié le 28 août 2012 dans Actualités par Volker Gilbert

Le site Adobelabs.com vient de publier ce matin les versions bêta publiques (RC) de Camera Raw 7.2 et Lightroom 4.2.